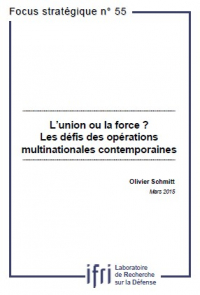Contrairement à ce que disent leurs défenseurs, les sociétés de projet actuellement étudiées ne sont pas la seule solution pour parvenir au niveau du budget de la Défense (31,4Md€) comme promis par le chef des armées. Pour combler ce budget, d'une mission régalienne s'il en est, via des ressources dites exceptionnelles, devenues ordinaires depuis plusieurs années, ces sociétés dédiées doivent permettre d’acquérir en 2015 pour 2,2Md€ de matériels jusqu’alors détenus par les armées, pour ensuite leur louer. Cela permettra de décapitaliser des actifs en étalant dans le temps les coûts. Cette mesure est censée éviter au ministère de la Défense une cessation de paiements dès cet été. Le 29 avril, un conseil de Défense doit définitivement trancher en faveur ou non d’une telle solution.
 A droite, un navire de guerre FREMM n'ayant pas à connaître lors de son utilisation de "risques de dommages élevés" (sic), donc potentiellement concerné par ces contrats type "sale and leaseback".Une solution conjoncturelle à un problème structurel
A droite, un navire de guerre FREMM n'ayant pas à connaître lors de son utilisation de "risques de dommages élevés" (sic), donc potentiellement concerné par ces contrats type "sale and leaseback".Une solution conjoncturelle à un problème structurel Ces sociétés sont un palliatif conjoncturel, non une solution structurelle, et ne font que repousser les choix et arbitrages à faire pour parvenir à l’adéquation entre missions et moyens. Si les missions sur le territoire national ou en opérations extérieures sont jugées prioritaires, qu’elles ne peuvent être réduites et demandent même une baisse dans la baisse des effectifs au sein des armées (jusqu'à 18.500 personnes), il est cohérent de fournir les financements nécessaires. C’est-à-dire 31,4Md€ "plus quelque chose" comme le demande le chef d’état-major des armées pour régénérer sans user, et rendre pérenne notre modèle de Défense avec les nouvelles orientations (Vigipirate, renseignement, cyberdéfense, aéromobilité, etc.). Par contre, il est incohérent d’annoncer, sans financements liés, de nouvelles mesures en cours d’année, alors que certains paris sur l’effectivité des financements, connus depuis plusieurs mois, ne sont déjà pas tous gagnés.
Certains parlementaires, de la majorité et de l'opposition, qui pointaient du doigt en 2012 les écarts d’exécution de la précédente loi de programmation militaire sont étrangement parfois les mêmes aujourd’hui à défendre ces sociétés. Or, ces dernières ne font que repousser encore plus la fameuse "bosse budgétaire", qui inclut notamment la dette interne de la Défense, ce "report de charges" d’impayés d’une année sur l’autre qui s’établit à 3,5Md€ environ (et augmente plus qu'il ne diminue). Si elles décalent dans le temps les paiements, elles renchérissant les coûts globaux (via la rémunération du capital, les assurances, etc.) de programmes d'armement, ayant déjà pourtant connus des dérapages.
La France, un État-stratège ?Ces sociétés sont aussi l’illustration d’un État français as de la godille, et non stratège. Sont-elles temporaires ? Permanentes ? Des services de maintenance sont-ils inclus ? Sont-elles limitées aux appareils de transports A-400M et aux frégates FREMM, présentés comme des matériels n’ayant pas à connaître "de risques de dommages élevés" (sic) ? Appelées à s'étendre à d'autres matériels (ravitailleurs, satellites) les années suivantes ? A quelques semaines de leur possible mise en œuvre effective, les réponses varient encore. Leur périmètre changeant, un entre-deux entre l’externalisation de capacités entières hors du cœur de métier (rentable sous certaines conditions) et une possession en patrimonial des matériels, n’est pas le moindre des revirements. Le fait même de faire appel à un tel montage l’est également.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 donnait, dans son introduction, comme préalable à l’autonomie stratégique un équilibre entre assainissement des finances publiques et effort consacré à la défense. Or, pour capitaliser suffisamment ces sociétés, il pourrait être nécessaire de faire appel à des établissements de crédits, pas le moindre des paradoxes, quand bien même la France emprunterait actuellement à des taux historiquement bas. En effet, les industriels de la Défense ont été peu intéressés par une participation à ces montages, pas assez rémunérateurs, ne concernant l'export (où l'Etat se porterait en partie garant), ou bénéficiant déjà pour certains d’autres solutions pour le faire à l'export. En plus des emprunts, le reste du capital serait obtenu via des cessions de participations de l'État au sein d’entreprises, manœuvre que l’Agence des participations de l’Etat (APE) juge comme "un investissement non avisé". Un État-stratège se séparerait-il vraiment d’actifs rentables, via les dividendes, pour payer plus chers des matériels, tout en amplifiant la dette plutôt qu’en la remboursant ?
 Ravitailleur Voyager mis à la disposition de la RAF par la société Air Tanker via la PFI (Private Finance Initiative), contractualisation peu éloignée des sociétés de projet, et considérée comme un frein à de possibles coopérations France-GB, selon le général Mercier (CEMAA). Quand nos enfants payeront demain la Défense d’hier
Ravitailleur Voyager mis à la disposition de la RAF par la société Air Tanker via la PFI (Private Finance Initiative), contractualisation peu éloignée des sociétés de projet, et considérée comme un frein à de possibles coopérations France-GB, selon le général Mercier (CEMAA). Quand nos enfants payeront demain la Défense d’hierCes sociétés sont également le symptôme du désengagement progressif des contingences politiques de la part des militaires français. Depuis la déclaration publique du chef d’état-major des armées en novembre 2014 sur le fait que de tels montages seraient des "usines à gaz", les militaires ne seraient qu’"un peu étonnés" d’un tel montage, selon l’expression du Directeur général de l’Armement (DGA). Sans plus, dès lors que leurs matériels sont disponibles en nombre et sans restrictions d’emploi (notamment dans le cadre des opérations ou de coopérations internationales, pour la formation ou l’entretien mutualisés). Ce qui serait en passe d’être presque acquis.
Simples experts (plutôt compétents aux vues des récentes opérations) de leurs domaines, ils ont créé un vide dans leurs relations avec les décideurs, les opinions publiques et la scène stratégique, n’ayant que peu de prises sur les débats en cours, quand bien même ils seraient au cœur de "la défense institutionnelle" de leur domaine. En effet, ces sociétés qui les concernent ne sont pas qu’une simple décision technique, mais bien une décision d’ordre politique, engageante et prise en connaissance de cause par les responsables actuelles. Elle touche en profondeur à notre modèle de Défense. Si les investissements d’aujourd’hui servaient jusqu’alors à bâtir la défense de demain, les investissements de demain pourrait potentiellement, via ces sociétés, servir surtout à rembourser la Défense d’hier.
Une autre voie, plus cohérente, est pourtant possibleAu final, ces sociétés ne sont donc pas la réponse à la problématique et l’unique solution comme prétendus par ceux qui, au nom du consensus national sur la Défense, ne veulent pas entendre de voix discordantes. En effet, une décision politique, courageuse, peut conduire à d’autres arbitrages. Autres que ceux de ne pas en faire, en ne tranchant pas dans les missions, ou d’en faire des juste suffisants ou des incertains (espérer plus d'économies sur les carburants du fait du prix encore bas du baril, miser sur suffisamment de projets finançables par la vente de fréquences 700MHz, décaler des paiements de matériels dont les livraisons sont retardés après des succès à l'exportation, etc.).
 L'appareil de transport A400-M, un programme industriel ayant déjà connu quelques retards et surcoûts, et dont la possession sera mécaniquement encore plus coûteuse via ces sociétés.
L'appareil de transport A400-M, un programme industriel ayant déjà connu quelques retards et surcoûts, et dont la possession sera mécaniquement encore plus coûteuse via ces sociétés.Un créneau politique favorable existe pour que les armées bénéficient dès cette année, de la part de ceux qui les sur-emploient, des crédits nécessaires à leurs missions, en quantité et en qualité. Ceux qui récriminent, en partie à juste titre, à mettre en œuvre de telles sociétés, seraient avisés de proposer un budget ne reposant pas en grande partie sur des montages aussi bancals. Une loi de finances rectificative, parallèle à "la densification" de la loi de programmation militaire prochainement présentée au Parlement, peut permettre de concrétiser ces choix dans les finances publiques.
Dans le cas contraire, une fois validées, ces sociétés seront une excuse facile pour proposer un budget de Défense toujours plus réduit en crédits budgétaires, et reposant toujours plus sur des ressources exceptionnelles (déjà 5,2Md€ d’ici 2017), trouvables via une multiplication de sociétés de projet. Un autre créneau politique s’ouvrira aussi à qui voudra prouver que le sens de l’Histoire, que certains convoquent pour défendre ces sociétés, est fait de continuités mais aussi de ruptures, et donc de possibles ré-internalisations via la clôture de telles sociétés.








.jpg)